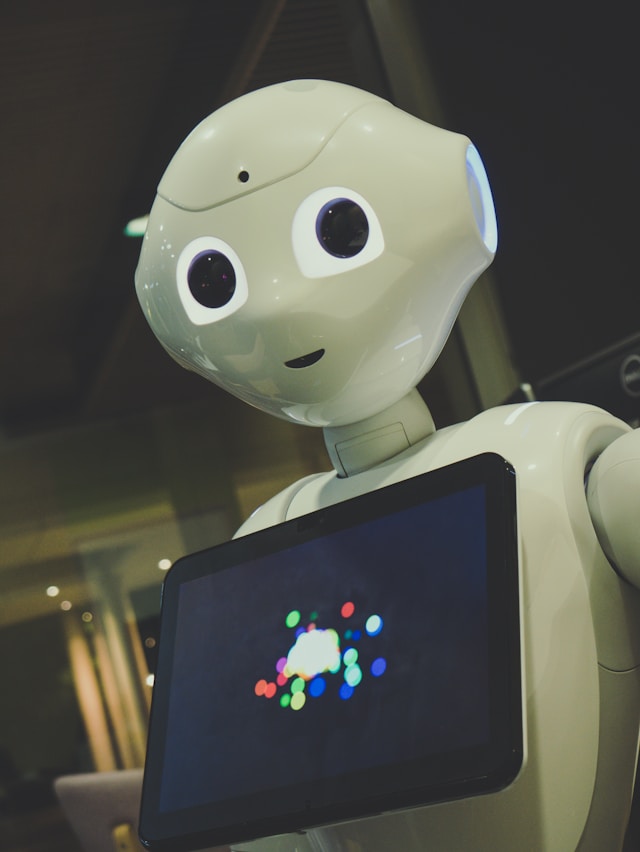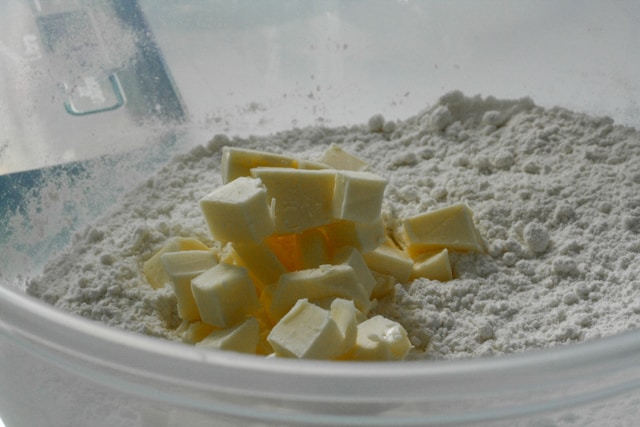Nox, une startup berlinoise spécialisée dans les trains de nuit, annonce le lancement en 2027 de trains de nuit dotés uniquement de chambres privées. Une trentaine de liaisons sera lancée dans un premier temps depuis l’Allemagne en direction de Barcelone, Paris, Milan ou encore Rome. L’entreprise va miser sur le confort, l’intimité et des prix compétitifs pour concurrencer les vols court-courrier.
Alors que les voyageurs sont de plus en plus soucieux de leur empreinte environnementale, le train gagne du terrain par rapport aux moyens de paiement comme l’avion et les bateaux. Cet engouement pour les rails se caractérise notamment par l’ouverture de nouvelles liaisons ferroviaires nocturnes. Malheureusement, les services ne sont pas à la hauteur des espérances. En effet, les compagnies ne proposent que des cabines partagées avec des inconnus. Et les cabines à deux lits ou individuelles sont trop onéreuses.
Des trains de nuit dotés uniquement de chambres privatives
Pour répondre aux besoins des voyageurs, la startup berlinoise Nox annonce le lancement en 2027 de trains de nuit dotés uniquement de chambres privées et à des prix très concurrentiels. Il y aura dans un premier temps une trentaine de liaison au départ de l’Allemagne (depuis Berlin, Francfort, Munich…) pour les principales villes européennes comme Barcelone, Paris, Milan, Rome, Vienne, Budapest et Stockholm. L’idée est de rester dans le rayon des avions courts-courriers, c’est-à-dire des liaisons n’excédant pas 1.500 kilomètres, soit 12 heures. Cela évitera les retards et les risques de dysfonctionnements liés aux très grandes distances.
Trois catégories de compartiments proposées
Nox se concentrera sur le confort avec des voitures composées de cabines privatives pour une à trois personnes. L’entreprise proposera trois catégories de compartiments : un loft simple pour un passager avec un lit supérieur (de 2 mètres) un fauteuil et une table ; un loft double avec un lit supérieur double, deux sièges et une table ; et une vista double avec des lits à accès facile, dont le plus bas peut se transformer en siège. Les cabines comprennent aussi des espaces de rangement et, dans certains cas, des fenêtres panoramiques. Elles peuvent être fermées à clé de l’intérieur comme de l’extérieur.
Des trains de nuit aux tarifs comparables à ceux des avions
Nox promet des prix à partir de 79 euros pour une chambre simple et 149 euros pour une chambre double. Ces tarifs sont comparables à ceux d’un billet d’avion, en plus des économies d’une nuit d’hôtel. L’entreprise souhaite concurrencer les vols court-courriers et devenir la meilleure option pour les voyages d’affaires en Europe. Thibault Constant, cofondateur de Nox et ancien chef de projet à la SNCF et chez Alstom, assure que son groupe va changer l’image du train de nuit et en faire « un pilier essentiel du voyage en Europe ». Il constate qu’ « aujourd’hui, les passagers doivent partager leur compartiment avec des inconnus », faire avec « des lits petits, inconfortables », ainsi qu’un « billet qui coûte souvent plus cher qu’un vol ». Ce qui n’est pas confortable ou facile.
Des experts des trains de nuit à l’origine de Nox
Thibault Constant est également le créateur de « Simply Railway », une chaîne YouTube et Instagram sur le train qui réunit 500.000 abonnés. Il a déjà passé 400 nuits en train de nuit, donc connaît très bien les attentes des voyageurs. Tout comme l’autre co-fondateur de Nox, Janek Smalla, qui a contribué au lancement de Flixtrain et dirigé l’activité de covoiturage de Bolt en Allemagne. Les deux entrepreneurs prévoient une importante levée de fonds cet automne pour préparer le lancement de leur service dès 2027. Un horizon plutôt ambitieux.
Une centaine de liaison à partir de 2035
Les fondateurs de Nox confient avoir déjà calé l’aménagement intérieur de leurs trains et que ceux-ci permettront de transporter plus de passagers par train que les modèles traditionnels. Ils affirment également avoir réservé des wagons de train et que ces voitures sont en phase finale d’homologation. Si Nox prévoit d’exploiter ses premiers trains de nuit dans toute l’Europe en 2027, la startup ambitionne de mettre en place une centaine de liaison à partir de 2035, toujours avec l’objectif de proposer des trajets courts. Elle a prévu un service de restauration à bord, de l’espace pour les vélos et des autocars accessibles aux fauteuils roulants. Un train de luxe à prix réduit donc !